Ces systèmes volcaniques, plutôt isolés (en particulier Kadovar), sont difficiles à suivre (Erta Ale est un peu simple tout de même). Toutefois l'imagerie satellitaire, qui n'est pas exempt de défauts malgré ses nombreux avantages, permet de faire un suivi au moins partiel : c'est ce que je vais tenter de faire dans le post qui suit, majoritairement Papoue.
Kadovar, Papouasie Nouvelle-Guinée, 365 m (environ)
Pour mémoire c'est en janvier 2018 que la première éruption historique a débuté sur ce système volcanique. Éruption plutôt tranquille, essentiellement marquée depuis par une émission à très faible débit d'un magma visqueux avec toutes les conséquences qui en découlent : formation de dômes de lave qui s’effritent dans la pente (versant est uniquement) en produisant des avalanches de blocs et, probablement, quelques écoulements pyroclastiques. Cette activité a progressivement modifié la topographie du versant est en comblant des ravines notamment. La dernière mise à jour le concernant remonte à octobre 2022 et tout laissait penser à ce moment-là qu'une activité éruptive, vraiment faible, se poursuivait toujours sur le mode "extrusion".
Toutefois en faisant le point sur les images satellites un détail m'a surpris : sur l'image du 09 mai le versant nord-est, et une partie du versant nord-ouest, semblait dépourvu de végétation. En comparant avec des images plus anciennes il était clair qu'il était couvert d'un dépôt de cendres récent puisque le même versant était couvert de végétation sur l'image du 24 avril.
Il semble donc qu'une activité explosive ait eu lieu entre ces deux dates et en consultant les archives du VAAC de Darwin j'ai effectivement pu trouver un bulletin indiquant la présence de cendres le 06 mai : il s'agit vraisemblablement de la date de mise en place de ce dépôt. L'altitude de ce panache a été estimée par la VAAC à environ 4500 m soit une hauteur d'environ 4100 m : c'est un panache d'un ampleur assez importante, qui tranche avec le reste de l'éruption qui fut plutôt tranquille. Il n'y a qu'au tout début de l'éruption que des panaches de cendres similaires ont pu être produits : c'est donc un événement qui contraste avec ce qui est habituellement détecté. À noter toutefois que la séquence semble avoir été brève et rien de similaire ne s'est produit depuis.
 |
| Le bulletin émis par le VAAC de Darwin le 06 mai 2023, indiquant la présence de cendres à une altitude d'environ 4500m .Image: VAAC de Darwin |
Lorsqu'elles sont suffisamment libres de nuages, les images post-06 mai montrent en outre que la morphologie du sommet a subit des changements. On y voit notamment une masse de roche plus claire dont la surface semble un peu chaotique. Sa forme est légèrement allongée dans la pente du versant est et un faible signal thermique est émis depuis la partie sommitale de cette structure. Tout cela ressemble à un nouveau dôme de lave, et même un dôme-coulée, puisqu'il semble allongé dans la pente.
 |
| Nouvelle structure rocheuse, possiblement un nouveau dôme, mise en place après l'activité explosive du 06 mai . Image : SENTINEL 2 - ESA/Copernicus |
Depuis lors ni la morphologie de cette structure, ni la teinte des dépôts, ni le tracé des côtes ni même le faible signal thermique n'ont connu de modification significative : la situation est, en surface, tout à fait calme et stable, ce qui ne laisse rien présager à priori de l'activité interne du système volcanique : il faut des mesures géophysiques et géochimiques pour s'en faire une image un tant soit peu structurée.
Situation calme pour le moment donc mais il vaut mieux garder un oeil : on sais jamais.
Sources : VAAC de Darwin; SENTINEL 2 - ESA/Copernicus
Erta Ale, Éthiopie, 613 m
Le mois de juillet fut marqué par une activité relativement soutenue avec, en particulier, la mise en place de nouvelles coulées dans le Pit Crater Nord autour du 07 juillet, comblant encore un peu plus celui-ci.
 |
| Activité effusive plus soutenue dans le Pit Crater Nord. Image : SENTINEL 2 - ESA/Copernicus |
L'activité dans le Pit Crater Sud a été persistante mais variable. Toutefois la seconde quinzaine du mois de juillet a été marquée par une phase d'activité accrue dans le Pit Crater Sud. Les images satellites montrent en effet un changement entre celle faite le 17 juillet et celle faite le 27 juillet (les images entre ces deux dates sont couvertes de nuages) : un coulée de lave a été produite par débordement du Pit Crater Sud, induisant que celui-ci est maintenant totalement comblé. Sur l'image ci-dessous la coulée est en cours de refroidissement: le débordement a eu lieu les jours précédents le 27 juillet et il faut noter que c'est une première depuis la phase d'intense activité qui avait marquée le tout début de l'année 2017 et la purge des deux Pit Craters.
 |
| Nouvelle coulée depuis le Pit Crater Sud : il est plein! Image : SENTINEL 2 - ESA/Copernicus |
 |
| Évolution des deux Pit Crater entre 2017 et 2023 : notez que leur remplissage est parfaitement synchrone, signe d'une alimentation commune. Images : SENTINEL 1 - ESA/Copernicus |
Ce nouveau champ de lave, long d'un peu plus de 500 m environ, couvre une surface d'environ 0.05 km² : c'est un débordement modeste, mais peut-être n'est-ce que le premier d'une série? Pour le moment en tout cas la situation est redevenue plus habituelle avec, probablement, une petite activité de spattering au niveau de l'évent situé en bordure sud du Pit Crater Sud.
Bagana, Papouasie Nouvelle-Guinée, 1750 m
L'activité au Bagana reste difficile à suivre avec précision du fait de l'absence d'instrumentation au sol, de l'isolement de l'édifice et d'une atmosphère souvent chargée de nuages limitant une visibilité depuis l’espace. Les images radar du satellite SENTINEL 1 permettent toutefois de constater que depuis mon post précédent concernant ce système volcanique (mai 2022, ça passe à une vitesse folle) l'effusion a continué et différent lobes de coulées d'une lave très visqueuse ont continué à s'accumuler les uns sur les autres sur le versant nord-ouest. Le dernier lobe répertorié sur cette séquence commence à se mettre en place en novembre 2022 et le front de coulée progresse lentement jusqu'en juillet 2023 : le taux d'effusion reste vraiment très faible, ce qui est habituel pour ce système volcanique.
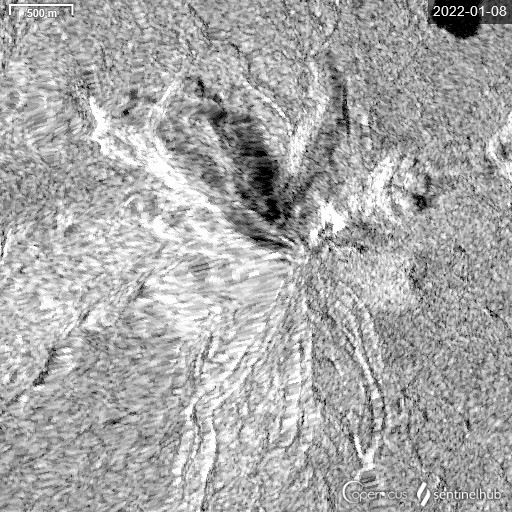 |
| Effusion de lave visqueuse à peu près permanente entre janvier 2022 et juillet 2023. Images : SENTINEL 1 - ESA/Copernicus |
Le début du mois de juillet a été marqué par deux phases d'activité, plus intenses que l'effusion habituelle, caractérisées par deux injections, les 07 et 14 juillet, de quantités relativement peu importantes* de SO2 dans l'atmosphère. Toutes deux ont produit des panaches, visiblement peu chargés en cendres qui, malgré une couverture nuageuse dense, ont été repérés jusqu'à une altitude estimée par le VAAC de Darwin à plus de 16 km : la tropopause.
 |
| Grosse quantité de SO2 dans l'atmosphère au-dessus de l'île de Nouvelle Bretagne le 08 juillet. Images/données : MODIS/NASA & Suomi NPP/OMPS |
Comment expliquer ces modestes mais néanmoins brusques injections de SO2?
Les images satellites faites les jours suivants permettent de constater la présence de dépôts couvrant une partie du quart sud-ouest. La surface couverte est d'environ 3,5km², le dépôt à un bord très net et ne semble pas vraiment tenir compte de la topographie locale : ce dépôt ressemble donc plus à ce que laisserait un écoulement pyroclastique dilué, ou une succession d'écoulements, qu'un panache de cendres dont le dépôt a des bordures plus diffuses. Une partie du dépôt a une teinte plus claire que le reste mais c'est peut-être tout simplement qu'il est sec (c'est la zone à plus haute température de l'ensemble du dépôt) et il ressemble beaucoup à un dépôt d'écoulement pyroclastique aussi. Cela pourrait correspondre à la partie dense de l'écoulement pyroclastique.
L’extrémité de cet ensemble de dépôts est digité ce qui peut être la conséquence à la fois de leur mise en place mais aussi d'une reprise par les eaux pluviales d'une partie du dépôt : l'image a été prise 3 jours après leur formation et la zone est réputée pour son fort taux d'humidité et sa pluviométrie, on ne peux exclure un début de remobilisation.
La quasi omniprésence des nuages ne permet pas d'avoir de détails pour le moment, mais la dernière image suffisamment "libre", en date du 23 juillet, permet de constater la présence d'un signal thermique fort dont la morphologie (allongée presque perpendiculairement à la pente) évoque furieusement le front d'une coulée visqueuse qui s'émiette sur le haut versant sud-ouest. Si cette interprétation devait s’avérer juste, alors cette coulée ferait un peu moins de 700 m de long.
Alors que penser de cette séquence? Honnêtement pas facile sans image de terrain mais si on fait le point:
- depuis plus de deux ans de gros volumes de lave sont lentement mis en place sous la forme d'épaisses coulées superposées sur le versant nord-ouest. L'effusion semblait moins importante ces derniers mois.
- les 07 et 14 juillet deux événements injectent dans l'atmosphère des quantités de SO2 modérées mais qui se déplacent à haute altitude (16 km). L'apparente contradiction entre un quantité modérée de SO2 (qui suggère un événement modeste) et l'altitude atteinte par ce SO2 (16km, qui suggère un événement intense) peut être résolue lorsqu'on constate que sur les images satellites ces injections de SO2 ont lieu alors que l'atmosphère locale est sujette à de puissants mouvements de convection verticaux (on voit bourgeonner rapidement d'imposants nuages).
-la possible formation d'une nouvelle coulée en direction du sud-ouest suggère aussi que c'est maintenant la voie la plus simple, alors qu'au cours des 2 années précédentes (et même plus) l'écoulement de la lave était plus simple vers le nord-ouest.
Un scénario possible et vraisemblable, mettant en cohérence l'ensemble, serait que les injections de SO2 seraient la conséquence d'une phase d’effondrement de la partie sommitale de l'édifice, peut-être en conséquence de l'arrivée d'une nouvelle masse de magma. Cet effondrement se produit en direction du sud-ouest provoquant la formation des dépôts d'écoulements pyroclastiques et le nouveau magma commence donc à s'étaler sous la forme d'une nouvelle coulée mais qui, cette fois, a le champ libre vers le sud-ouest.
Il ne peux être exclu, dans ce scénario, que l'effondrement et les écoulements pyroclastiques soient la source des injections de SO2 mais il n'est pas impossible non plus que l'effondrement ait permis une brusque décompression du haut de la colonne de magma, donc une activité explosive qui expliquerait aussi les injections de SO2.
Un autre scénario possible est la survenue d'une phase explosive qui modifie la morphologie du sommet. Des écoulements pyroclastiques sont produits pendant cette phase explosive mais le magma responsable de cette hausse d'activité s'écoule vers le sud-ouest en suivant la topographie retouchée par les explosions.
La différence entre les deux est que dans le premier l'activité explosive éventuelle est une conséquence d'un effondrement alors que dans le second elle en est la cause.
Il est honnêtement trop tôt pour être sûr de ce qui s'est produit mais en tout cas les injections de SO2 ne sont pas obligatoirement la conséquence d'une activité explosive intense malgré l'altitude atteinte par le SO2 : il se pourrait que l'activité observée ces dernières années (mise en place tranquille de coulées visqueuses successives) n'ait, au fond, pas changé en terme d'alimentation ou de type de magma, mais qu'un événement superficiel (une fragilité du sommet) ait momentanément modifié l'activité puis que le SO2 ait été apporté par les convections atmosphériques à haute altitude, donnant l’illusion d'un événement plus important qu'il ne le fut.
Cette idée est cohérente avec le fait que le SO2 a pris une forme annulaire dans l'atmosphère : le SO2 est injecté dans une convection, le nuage en développement arrive à la tropopause et s'étale en poussant le SO2 dans toutes les directions, formant ainsi l'anneau.
 |
| Un anneau de SO2 dans l'atmosphère le 07 juillet (14h20 TU). Image: Himawari 8 |
* respectivement au moins 2000 tonnes et 1500 tonnes d'après les données satellites : en comparaison ce sont 5000 tonnes qui étaient estimées présentes dans l'atmosphère le 11 juillet à cause de l'éruption à Fagradasfjall
Sources: SENTINEL 1-NASA/USGS; MODIS/NASA & Suomi NPP/OMPS; LANDSAT 8/9 - NASA/USGS; Himawari 8 via Prof Simon Carn (Michigan Tech)



Bonjour, Pour le BAGANA il s'agit d'une activité explosive ( la population locale a été évacuée et les cultures détruites ou impropre à la consommation) . Ici une vidéo de ce volcan ( pas de date mais très intéressant ) . https://www.youtube.com/watch?v=_tECglF3Mqg
RépondreSupprimerPour le ERTA ALE j ai trouvé ça HORNITOS https://www.facebook.com/watch/?v=246903044894981
Pour le Lengai confirmation Juin/Juillet hausse du plancher. Alors que d'un Hornito seule une chaleur rouge faible était visible au-dessus de l'ouverture, un trou plus grand scotché à l'extrémité d'un autre, d'où on pouvait voir de la lave bouillonner. L'activité a provoqué une faible anomalie de chaleur, qui est également visible sur une photo sentinelle dans la plage infrarouge. Les deux aventuriers ont également signalé une sécheresse persistante dans la région autour de la volcan. https://www.vulkane.net/blogmobil/ol-doinyo-lengai-neue-fotos-am-05-august/